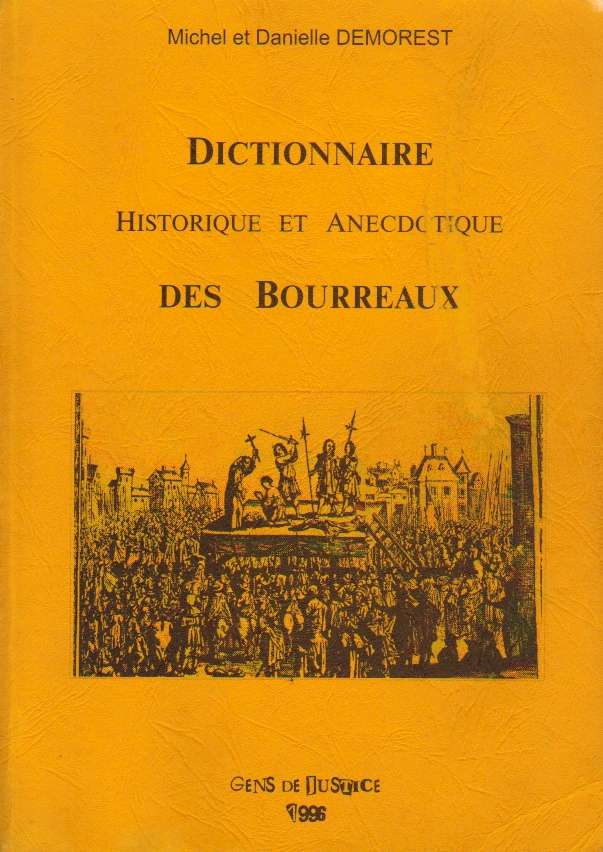 Dictionnaire historique et anecdotique des bourreaux
Dictionnaire historique et anecdotique des bourreaux
Gens de justice
1996
Broché
446

Extraits
- Avant-propos
- Quand il n’y avait pas de bourreau
- L’arrivée du bourreau
- Le glossaire des bourreaux
- A lire …
Avant-propos de la première édition (1996)
En septembre 1992, par suite d’une « déconvenue professionnelle », je me retrouvai avec un capital-loisir assez confortable. Musicien à mes heures perdues, j’avais largement dépassé l’âge pour me lancer dans la chanson. Aussi, moins par ennui que par curiosité, je m’investissai dans la généalogie, activité de plus en plus prisée depuis le bicentenaire de la Révolution Française.
De vagues souvenirs d’enfance, où je feuilletais le dictionnaire à reconstruire la généalogie des rois de. France, m’autorisaient à penser que cette science était frite pour moi. De plus, le bruit avait couru dans la famille que nous étions descendants de… bourreaux.
C‘était le moment où jamais de me remuer, de me lancer dans la bagarre, comme disait mon ancien patron, dans les semaines qui précédèrent notre séparation. Encouragé par mon épouse, j’expédiai bientôt mes premières demandes d’état-civil aux administrations concernées.
Janvier 1993; hélas, pas de bourreaux en vue; seuls des fileurs de laine et des agriculteurs se balançaient aux branches de mon arbre généalogique. Moi, qui croyait être un Parisien de longue souche, voilà que, de surcroît, je me trouvai des ancêtres en Champagne et dans le Lyonnais.
Les quelques déplacements dans les bibliothèques, archives et cimetières de ces belles régions ne me délivrè rent pas d’une torpeur naissante.
Était-ce déjà la fin?
Au printemps suivant, une soirée Minitel, mais surtout l’ordinateur géo-patronymique du Centre Pompidou ravivèrent mes espoirs. Une dizaine de DEMOREST vivaient aux quatre coins de la Fronce et, notamment, le prénommé Pierre, au pays de la lavande. Il avait effectué des recherches généalogiques assez poussées et pouvait me renseigner aisément, m’avait expliqué sa petite-fille au téléphone. Au bout du fil, le sympathique retraité me détailla bientôt le fruit de ses recherches, mais, à aucun moment nous ne pûmes les faire s’imbriquer dans mes propres découvertes: nous n’étions pas cousins !
Au moment de raccrocher, mon correspondant manifestement déçu, lâcha un dernier et péremptoire argument
– En tout cas, mes ancêtres étaient officiers du roi.
– C’est-à-dire?
– Eh bien, ils étaient exécuteurs de la haute justice.
– …
– Bourreaux, ils étaient bourreaux, enchérit-il!
Quelques jours plus tard, Danielle (mon épouse) et moi étions dans le T.G.V. à la rencontre de mon lointain cousin.
Pierre DEMOREST avait effectivement débusqué toute une armada de maîtres des hautes oeuvres qui, comble de l’horreur, m’étaient au trois-quarts attribués. Le brave homme avait relancé mes recherches et donner le coup d’envoi à une longue et extraordinaire enquête, qui allait me conduire aux quatre coins du pays.
Toute cette fin d’année fut consacrée à la reconstitution de la vie de mes ancêtres Champenois (bourreaux de Châlons durant un siècle !), puis Picards (bourreaux de Laon à partir de 1664). Alliés aux exécuteurs de Lorraine (familles ETIENNE, PICLER, ROCH) et de Normandie (familles JOUENNE, FEREY, LACAILLE), nous refîmes le chemin qui nous conduisit bientôt aux portes de la Bretagne puis dans le centre du pays. Cet hiver là, nous étions en « mission » à Nîmes, Carpentras, Aix-en-Provence… Avant de cesser cette fastidieuse énumération, laissez-moi ajouter que nous avons même trouvé un Louis Henry DESMOREST, bourreau de Bastia à la fin du siècle dernier.
En 1994, une vingtaine d’autres archives départementales et communales furent visitées et leurs registres paroissiaux et d’état-civil passés au crible. Nous commencions à nous organiser. Danielle se spécialisait dans l’état-civil (les actes en latin où se nichait le « carnificis » local n’échappait pas à sa sagacité), quant à moi, je m’occupais de fouiner dans les revues savantes, les journaux d’époque, c’est-à-dire tout le reste.
Des milliers (j’insiste sur ce mot) d’actes furent déchiffrés, retranscrits, photocopiés, nous révélant des trésors généalogiques inestimables et inédits. Déjà les fameuses dynasties d’exécuteurs prenaient forme et certaines idées reçues s’estompaient. Rien de tel qu’un descendant de bourreau pour reconstituer l’imbroglio de ces ancêtres. Des dispenses de mariage pour consanguinité, eh oui, des actes notariés, des jugements et sentences divers rendus à leur égard, apportaient la dimension humaine que nous leur contestions.
Nous dévorions les fichiers matières de ces archives, disséquions les rubriques Bourreau, Exécuteur, Guillotine, Pilori, Havage, Justice, etc., parcourions les vieux ouvrages retraçant l’histoire des villes, des rues et des places, visitions des Monts-de-Justice, des églises, des musées pour retrouver l’empreinte de nos héros.
Petit à petit, nous devenions des spécialistes de la justice criminelle. Nombre de documents de la série B, L et U, des archives départementales et leurs homologues en communales, furent littéralement disséqués.
Les remboursements de frais de justice du bourreau (série C), les transferts de prisonniers par ses soins (série I), les recensements (série F) etc., furent de précieux compléments d’informations.
Combien d’heures avons-nous passé aux Archives Nationales à lire, et relire, les séries BB3 et BB3O, et quelques autres, particulièrement la célèbre V1 540 (lettres de provision d’office des bourreaux). Le Minutier Central des dépouillements des actes notariés nous apprit que je descendais indirectement du tristement célèbre bourreau de Paris, Jehan GUILLAUME; mais si ! souvenez-vous ! Ravaillac en 1610…
Les bibliothèques régionales, ainsi que la Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque Publique d’information (Beaubourg), vinrent grossir nos archives personnelles. L’incontournable livre de Jacques DELARUE (Le Métier de Bourreau), ainsi que divers ouvrages sur DEIBLER, SANSON, OBRECHT etc., nous furent des documents de base fort utiles.
Et puis, un jour, nous découvrîmes la guillotine, touchâmes les glaives de justice, serrâmes la main du plus jeune exécuteur des arrêts criminels encore vivant.
Notre documentation devenait impressionnante, voire envahissante. Ce n’était plus une histoire de famille que nous constituions, mais bel et bien un inventaire de la fine fleur de la « bourreaucratie » française. Mes proches commençaient à me suspecter d’une certaine morbidité et se demandaient si je ne décrochait pas un peu des réalités quotidiennes. Pourtant, c’était aussi leurs ancêtres…
Si quelquefois les exploits des exécuteurs me faisaient tousser de gêne, mon épouse, quant à elle, était radieuse de cette vie culturo-touristique qui la consolait de ses sages ancêtres boulangers à Lormes (Nièvre) et lui faisait me pardonner mes frasques agnatiques.
Quelque part, dans un souci de servir l’histoire, plus que d’obtenir un contrat d’édition, nous entreprîmes alors d’écrire ce dictionnaire. L’ordinateur fait bien les choses.
De la Marquise de Brinvilliers, au supplice de Louis XVl, en passant par l’exécution de Buffet et Bontemps, sans négliger les exécutions pratiquées dans la France profonde du siècle dernier, la quasi-totalité des décapitations, pendaisons et autres divers supplices qu’ont subi d’illustres ou d’anonymes ancêtres sont maintenant retranscrits sans complaisance dans ce livre.
Bien sur, au hasard des pages, on ne pourra toutefois pas retenir quelques frissons, quelque étonnement, quelques indignations, voire quelques éclats de rire devant tant d’originalité.
Un feu d’artifice d’anecdotes, dont la plupart inédites, ont été réunis des quatre coins de la Fronce, voire aussi de Suisse, de Belgique. d’Italie ou de Hollande, nos vieux départements du début du XIXe siècle.
Figurez-vous que les bourreaux furent plus de 2000, issus pratiquement d’une dizaine de familles qui exerçaient depuis Henri IV.
Par exemple, le bourreau de Paris, à lui seul, à généré une dynastie de plus de deux-cents exécuteurs, dont l’un des descendants exerçait encore à Paris en 1951.
Quel choc, peut-être, d’apprendre qu’on est, peut-être, leur descendant Et si notre ancêtre avait été assassiné, ou bien, s’il avait été l’aide de l’exécuteur, le lieutenant-criminel du bailliage où exerçait le maître des hautes œuvres, etc. Sachez que tous les personnages environnant le bourreau sont mentionnés dans cet ouvrage.
Attention aux idées reçues, les bourreaux ne se mariaient pas qu’entre eux; ils n’étaient pas que de simples manants, de vulgaires condamnés qu’on sortait de prison pour annuler leur peine en échange d’une tête tranchée. Beaucoup d’entre-eux étaient « Officiers du Roy ».
Messieurs les charpentiers, accordeurs de pianos, vétérinaires ou chirurgiens d’aujourd’hui, sachez que naguère nos amis les bourreaux excellaient dans votre art, où d’aucuns se sont reconvertis dès que l’occasion se fût présentée.
Aujourd’hui, nous pensons utile de mettre un terme à l’écriture de ce dictionnaire afin de vous faire bénéficier dès à présent de ces recherches que n’ont pas toujours pu mener au bout d’illustres prédécesseurs.
Michel Demorest
Quand il n’y avait pas de bourreau
Selon la formule consacrée, l’origine du bourreau se perd dans la nuit des temps. Ainsi, on a retrouvé en Espagne des peintures préhistoriques montrant un homme désarmé abattu à coups de flèches par des archers et, en Égypte, des documents montrant des scènes de pendaison et de décapitation bien avant les premiers pharaons. Mais il est permis de se demander dans quelle mesure il s’agit d’exécutions capitales au sens actuel du terme (c’est-à-dire à la suite d’un jugement), ou plutôt de sacrifices humains, destinés à se concilier les dieux. Ni chez les Juifs, ni chez les Grecs, on ne trouve trace d’une institution pareille. Chez les Juifs, le condamné était livré au peuple, qui le lapidait; chez les Grecs, l’homme condamné à perdre la vie prenait, dans la prison, au milieu de sa famille et de ses amis, un poison préparé de manière à lui procurer une mort prompte et sans douleur. On donnait à son supplice l’apparence d’une mort volontaire.
En Judée, comme à Rome, le peuple exécutait lui-même la sentence. Les Gaulois, quant à eux, choisissaient volontiers des criminels pour leurs sacrifices humains. Plus tard, il est vrai, les licteurs, furent chargés de cette exécution. Mais bien rares sont les cas où l’expiation du crime fut l’œuvre d’un seul. Le coupable était poursuivi par le peuple jusqu’au haut de la roche Tarpéienne, d’où il se précipitait. Dans certaines sociétés, le soin de l’exécution était laissé à la famille de la victime: c’était en somme la vendetta organisée. Cependant, l’idée de dissuasion se développa parallèlement à celle de punition, et la peine capitale fut rarement simple dans les sociétés même déjà évoluées. Elle était assortie et précédée de supplices divers, qui visaient tous à intimider les futurs criminels. C’étaient, entre autres, le pal oriental, les supplices chinois particulièrement raffinés, la crucifixion, l’écartèlement, le bûcher, etc.
L’arrivée du bourreau
| Les hautes œuvres et les basses œuvres | ↑ |
En France, il faut arriver au treizième siècle pour trouver trace d’un individu chargé de fouetter, marquer, pendre, décapiter, rouer et brûler au nom de la loi, Il était désigné alors sous le nom de exécuteur de la haulte justice, ou maître des hautes œuvres, et chaque grand bailliage en possédait un. Il accomplissait ainsi les hautes œuvres du seigneur local. C’était d’ailleurs un métier qui demandait un certain apprentissage, car il fallait, suivant le texte d’une ancienne ordonnance que le bourreau sceut faire son office par le feu, l’espée, le fouet, l’écartelage, la roue, la fourche, le gibet, pour traîner, poindre ou piquer, couper oreilles, démembrer, flageller ou fustiger, par le pillory ou eschafaud, par le carcan et par telles autres peines semblables, selon la coutume, mœurs ou usages du pays, lesquels la loy ordonne pour la crainte des malfaiteurs. Les basses œuvres, comme son nom l’indique, consistaient à s’occuper de travaux beaucoup plus terre à terre, comme le nettoyage des rues, la vidange des eaux usées, la mise des chiens en fourrière, etc., ce qui permettait au bourreau d’arrondir ses fins de mois quand les condamnés au supplice se faisaient rares. Il y avait à cette époque deux signes visibles de justice: le gibet, qui ne servait que pour les supplices capitaux, et le pilori, destiné au châtiment de fautes assez légères.
| Le gibet |
Le gibet, appelé aussi fourches patibulaires, était toujours installé dans les champs, sur un monticule et en bordure d’une voie fréquentée. On n’y accrochait que les dépouilles des suppliciés, préalablement mis à mort. Ces pendus restaient accrochés au gibet jusqu’à la désintégration du corps. Plus il y avait de gibets à l’entrée d’une ville et plus le seigneur était puissant. Un châtelain n’avait droit qu’à trois pendus, un duc à huit. Le gibet de Paris, dit de Montfaucon, pouvait en comporter jusqu’à seize; on y pendait parfois les condamnés vivants. C’était le bourreau qui se chargeait du transport et de l’ensevelissement des cadavres.
A proximité des gibets, on cultivait parfois des jardins où, à Paris, quelques guinguettes s’étaient installées. François Villon en fut un assidu avec ses compaings, lesquels furent plus tard également pendus.
Au XVe siècle, on eut coutume d’enterrer vivantes à proximité de l’endos du gibet, des femmes condamnées à cette mort que l’on jugeait alors plus décente pour elles que la pendaison.
| Le pilori |
On désignait sous le nom de pilori, un poteau où le bourreau exposait les personnes coupables de délits commis sur le territoire du seigneur. Le pilori était parfois situé au haut d’une maison en pierre qui servait de logis au bourreau. Il n’en existait qu’un par ville et il était toujours situé dans un lieu apparent, carrefour ou place publique. A Paris il était installé aux Halles, à peu près au débouché actuel de la rue Pirouette dans la rue Rambuteau. Les condamnés au pilori étaient sujets aux railleries du public, qui pouvait leur jeter de la boue et des ordures, mais non des pierres. Certains piloris, hautement perfectionnés, comme celui de Paris, pouvaient tourner sur eux-mêmes ce qui faisait qu’après deux heures d’exposition, les patients avaient fait un tour complet. On y exposait aussi des malheureux suppliciés, voire des têtes coupées.
Cette peine, encore en vigueur au milieu du XVIIe siècle, fut atténuée en 1666, par un décret de Louis XIV. Il faudra attendre 1832, pour que la peine du pilori soit remplacée par une simple exposition publique dans la cour du palais de Justice.
| Les rifleurs, les bingres |
La situation du bourreau variait d’une province, d’un bailliage voire d’une châtellenie à l’autre. Dans l’Est de la France, par exemple, le bourreau était souvent un homme issu de la bourrellerie, de la tannerie, ou de l’équarrissage; on le surnommait le rifleur. Au Sud de la Loire les bourreaux étaient souvent des occasionnels, surnommés les bingres par les bourreaux dynastiques. Parfois même, pour exercer le terrible office, les magistrats faisaient appel à d’anciens criminels qu’ils sortaient de prison pour leur éviter la corde ou les galères.
Au début du XVIIe siècle, la loi du Roi prévalait de plus en plus sur celle du Seigneur, qui se désintéressa alors de l’exercice d’un pouvoir qu’on lui contestait et qui ne lui rapportait plus guère. Aussi, faute de moyens, les sentences étaient souvent sans exécution, même en effigie.
| Les lettres de provision d’office |
Peu à peu, les bourreaux se mirent au service du roi, qui leur délivra des lettres de provision, les rendant propriétaires de leur office. Le bourreau devint ainsi Officier du roy, s’accaparant les offices des bourreaux occasionnels, et retransmit bientôt la charge à ses propres enfants, se faisant ainsi l’inévitable fondateur d’une incroyable dynastie. Quand l’enfant était encore mineur, les lettres de provision le pourvoyaient en survivance, pour qu’en cas de décès du père, l’office leur revint de droit dans leur vingtième année. Comme pour les rois, un régent assurait l’intérim dans cet intervalle de temps. Reclus dans leur microcosme, les bourreaux n’en obtenaient pas moins, sans aucune difficulté, toutes les dispenses nécessaires pour épouser leur cousine germaine, parfois même leur nièce.
| Les questionnaires et autres tourmenteurs |
Ce n’est qu’en 1674 que Louis XIV dissout définitivement les hautes seigneuries françaises et fit, enfin, régner sa propre loi. Cette fois-ci, et jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les exécutions furent hiérarchisées en fonction de l’extraction du condamné; le noble était décapité, le voleur de grand chemin roué en place publique. Le régicide et le criminel d’État étaient écartelés, le faux monnayeur était bouilli vif dans un chaudron, l’hérétique brûlé, le domestique, voleur de ses maîtres était, quant à lui, pendu, etc. Le questionnaire, bourreau spécialisé dans l’art d’appliquer les tortures, officiait dans l’obscurité des prisons et arrachait les plus fantaisistes aveux aux prisonniers déjà jugés ou condamnés à mort. La question était réservée pour les prévenus accusés d’un crime ayant entraîné la mort, ou qui avaient tout simplement fabriqué de la fausse monnaie. Cette torture comportait deux degrés dans son exécution: la question préparatoire, qui s’appliquait à l’accusé qui n’avouait pas, afin de le forcer à avouer. Elle fut abolie par Louis XVI en 1780. La question préalable, quant à elle était appliquée au condamné à mort soupçonné d’avoir eu des complices, pour le contraindre à avouer leurs noms. La torture la plus célèbre s’appelait le supplice des brodequins. Il était très simple dans son principe. Le malheureux était solidement animé à son siège et fermement tenu par un assesseur, pour éviter les ruades furieuses que pourraient provoquer la douleur. Des carcans de bois entouraient le bas de ses jambes: ils servaient de guides aux coins de bois que l’assesseur allait lui enfoncer dans les genoux à grands coups de maillets, jusqu’à lui broyer les os. Et accessoirement, évitaient que ces pieds ne se disloquassent pas sous les coups de boutoir. Les prêtres, les femmes enceintes, les nobles, les enfants et les magistrats en étaient en principe exempts. Si l’accusé subissait la torture sans rien avouer, il était déclaré innocent et mis en liberté; on devait alors lui faire connaître son dénonciateur pour qu’il pût demander réparation.
A cette époque, on exécutait même les animaux, et on expédiait à la mort, pour un simple larcin, non seulement des femmes, mais aussi des enfants.
| Le droit de havage |
Le bourreau professionnel, suscitait partout une horreur quasi sacrée. Il vivait à l’écart, portait des vêtements spéciaux et les honnêtes gens fuyaient tous son contact. On refusait ses enfants dans les écoles, on rechignait à lui vendre des marchandises. En ville, le pain posé à l’envers sur l’étal du boulanger était réservé au bourreau; personne d’autre n’y touchait. On humiliait le bourreau de toutes les manières. Celui-ci, comme émoluments, percevait alors une foule de droits en nature sur les marchands des halles; c’est ce que l’on appelait droit de havage, et qui consistait, pour lui, à pouvoir prendre une certaine quantité de légumes, de viande ou de poissons dans les paniers sur lesquels il étendait la main. La seule apparition du bourreau sur les foires et dans les marchés paralysait les marchands. Ils tremblaient de peur quand celui-ci, pour se reconnaître dans la perception de son droit, désignait ceux qui le lui avaient payé en leur imprimant avec de la craie jaune, une croix sur l’estomac ou l’épaule. Les injures, les rixes, voire les procès étaient courants entre le bourreau et les forains. Il avait, en outre, des droits fixes sur certaines autres denrées entrant à Paris, sur les dépouilles des condamnés à mort, et recevait une somme fixe par exécution. Entre autres profits, il avait la vente de la fameuse graisse de pendu, un remède souverain pour toutes sortes de maux, disait-on; et encore de la corde ayant servi à la pendaison, spécifique infaillible pour gagner un gros lot à la loterie. Il était aussi rebouteux et remettait en place les membres démis ou cassés, lui qui les brisait si bien aux malheureux attachés à la roue.
Le droit de havage fut aboli le 6 juin 1775, au grand soulagement des villageois et des paysans. Il fut remplacé, pour le bourreau de Paris et ses aides, par un traitement fixe de 16000 livres par an; on lui remboursait, en outre, le prix des fournitures qu’occasionnaient les exécutions, tant à Paris que dans l’étendue de la généralité et la juridiction du parlement.
| La guillotine |
La loi du 6 octobre 1791 supprima la torture préalable et uniformisa les peines: tout condamné à mort aura la tête tranchée. La guillotine fit sa première apparition place de Grève à Paris le 23 avril 1792, décapitant un voleur nommé Nicolas Pelletier.
En 1793, la Convention nationale réforma complètement la législation criminelle en ce qui concernait les exécuteurs. Par un décret du 13 juin 1793, elle décida qu’il y en aurait un dans chaque département de la République, et mit son traitement à la charge de l’État. Après la Terreur, la Convention supprima la peine capitale à dater du jour de la publication de la paix générale (loi du 4 brumaire an IV). Aux exécutions capitales se substituèrent les expositions publiques et les marques au fer rouge. Tout forçat recevait, avant de partir pour le bagne, les lettres infamantes sur l’épaule: TF, pour les voleurs ou les faussaires condamnés à temps et TFP pour les agresseurs ou les assassins condamnés à perpétuité, chacune des inscriptions étant précédée du numéro départemental. La Seine ayant l’indicatif 87, un Parisien condamné à temps portait toute sa vie la marque indélébile: 87 TF. Le Consulat prorogea temporairement ces mesures par sa loi du 4 nivôse an X.
Sous l’Empire et sous la Restauration, Louis Philippe réduisit le nombre des bourreaux et de leurs aides, mais il oublia l’abolition. Le Code pénal, récemment promulgué, stipula même que le parricide aura la main coupée avant d’être décapité. Sous le second Empire, il n’y eut plus qu’un bourreau par Cour d’appel, et le traitement varia suivant l’importance des villes. Enfin, un décret de novembre 1870 réduisit leur nombre à trois: un pour la France continentale, un pour la Corse, un pour l’Algérie.
| Les derniers bourreaux |
Le premier projet de loi abolissant la peine de mort fut discuté à la Chambre des députés en 1908. Aristide Bruand, alors Ministre de la justice, était partisan de l’abolition, ainsi que Jean Jaurès. Mais Maurice Barrès étant pour le maintien, la peine de mort, et son exécuteur furent maintenus. A partir du 24 juin 1939, le public n’eut plus le droit d’assister aux exécutions, puis la presse se vit interdire tout commentaire relatif aux exécutions et dut s’en tenir aux procès-verbaux (1951). La loi d’abolition de la peine de mort fut votée le 9 octobre 1981, et le dernier bourreau fut discrètement mis à la retraite.
Le glossaire des bourreaux
ABDECKER : Équarrisseur, éboueur.
AIDE-BOURREAU : Comme son nom l’indique, c’était l’aide du bourreau. Selon son âge, ses compétences, ou son ancienneté, cet individu était gratifié d’un grade qui le rapprochait de la fonction suprême: Exécuteur en chef. MAÎTRE DES BASSES ŒUVRES, selon les régions (Est de la France), adjoint de première, deuxième, voire troisième classe, selon les époques, l’aide bourreau succédait littérairement au VALET DE BOURREAU, chargé, sous l’Ancien Régime, de récolter le produit du HAVAGE sur les marchés; d’où sa fameuse réputation d’insolence à l’égard des marchands. Il était généralement le cadet de la famille dont l’aîné avait succédé au père, ou bien le fils de l’exécuteur voisin. Parfois, dans le milieu du XIXe siècle, c’était tout simplement le charpentier de la ville, futur gendre du maître. A partir de 1832, l’aide bourreau disparut de la profession et fut remplacé par les anciens bourreaux mis au chômage par les précédents décrets. Dès 1849, ce furent les bourreaux des Cours d’assises qui devinrent les adjoints des exécuteurs des Cours d’appel. A partir de 1871, seul subsistait le bourreau de France qui disposait de trois à cinq adjoints, dont un spécialiste surnommé le PHOTOGRAPHE.
AMENDE HONORABLE : Confession. Chaque condamné à mort avant son exécution était tenu de faire amende honorable au-devant de la porte de la principale église de la ville où il était conduit dans un tombereau par l’EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE, nuds pieds, nue tête et en chemise, ayant la corde au col, tenant en main une torche de cire ardente du poids de deux livres, ayant écriteau au devant et derrière portant l’inscription de son crime. Là, à genoux, il déclarait, à haute et intelligible voix que méchamment, témérairement et mal avisé, il se repentait du crime qu’il avait de dessein prémédité. Il demandait pardon à Dieu, au Roy et à la Justice et, ce fait, il subissait sa peine: BANNISSEMENT, ou LANGUE COUPÉE, ou POING COUPÉ suivit du châtiment suprême.
BALZMEISTER : Bourreau suisse (fin du XVIe siècle à Rheinfelden).
BANNISSEMENT : Lorsque le bourreau avait à faire à un condamné au bannissement du royaume ou de la province, le FOUET à la main, après avoir fait AMENDE HONORABLE, il conduisait le banni à la porte de la ville et, en signe d’expulsion, lui appliquait un vigoureux coup de pied dans les fesses.
BASSES ŒUVRES : Toutes exécutions sans mise à mort, pratiquées à hauteur du sol, par opposition aux HAUTES ŒUVRES qui conduisaient à la mise à mort et qui s’exécutaient sur un ÉCHAFAUD. Par extension les basses œuvres incluaient également tout travail de voirie et, parfois, la chasse aux chiens errants.
BÉCANE (LA) : Surnom donné à la GUILLOTINE au XXe siècle.
BOURREAU : mot très familier pour désigner l’homme chargé de mettre à exécution les peines corporelles prononcées par une cour criminelle, notamment la peine de mort.
BOURRELLE : Femme du bourreau.
BÛCHER : Peine de mort par le feu, aussi ancienne que l’humanité (Jeanne d’Arc, les Templiers). Lorsqu’un criminel avait été condamné à être ars, c’est-à-dire brûlé, on plantait en terre, ou sur un amoncellement de bois, un grand poteau autour duquel on préparait le bûcher composé de couches superposées de bûches et de paille, s’élevant à peu près à hauteur d’homme. Le bourreau et ses aides avaient soin de ménager près du poteau un espace libre suffisant à contenir le condamné debout. Le criminel, après avoir été dépouillé de ses vêtements, était revêtu d’une chemise soufrée. Puis on le faisait pénétrer au centre du bûcher par l’étroite ouverture prévue à cet effet, et on le liait solidement au poteau avec des cordes et des chaînes. Alors on remplissait les intervalles encore libres, après l’introduction du condamné, avec des fagots et de la paille jusqu’à ce qu’il en soit recouvert Ensuite on mettait le feu de tous côtés à la fois, et les flammes dévoraient lentement le malheureux supplicié.
BRODEQUINS : voir QUESTION.
BUTTEL : Bourreau suisse ou alsacien, mais aussi agent de la communauté, appariteur de justice, percepteur de redevances (ce dernier est aussi le Seckel ou Seckelmeister).
CARCAN : Collier large de trois doigts, s’ouvrant par une charnière. Le carcan était attaché par une chaîne à un poteau planté sur une des places de la ville. Le condamné, à pied, les mains liées devant et attachées à la charrette de l’exécuteur était conduit à ce poteau. Le bourreau y faisait entrer le cou du patient et le refermait avec un cadenas. Au-dessus de la tête du condamné ou sur sa poitrine on plaçait un écriteau portant son nom et la cause de sa condamnation: voleur, banqueroutier, usurier, etc. Il restait en cet état le temps fixé par l’arrêt. Comme le BANNISSEMENT s’ensuivait d’ordinaire, on mettait à côté de lui son chapeau renversé sur une chaise de paille. C’est là que les âmes charitables déposaient leurs aumônes pour aider le malheureux à faire son voyage.
CARNIFICIS : (latin) Bourreau.
CHARGE : voir LETTRE DE PROVISION D’OFFICE.
CRAVATE-À-CAPET (LA) : Surnom donné à la guillotine sous la Révolution.
DÉCAPITATION : Peine de mort pour les gens de la haute société sous l’Ancien Régime. Son principe résidait dans l’action de couper le cou, c’est-à-dire de séparer la tête du tronc. Il existait deux modes de décapitation: le GLAIVE ou la HACHE.
DÉCOLLATION : C’est l’action de trancher le cou. Sil ne devrait s’employer que comme un terme chirurgical, le mot est cependant couramment utilisé pour décrire les supplices des saints dont les têtes furent tranchée.
DIELE : Tranche-tête (ancêtre de la guillotine) en usage en Allemagne au XVe Siècle. Le bourreau frappait avec une lourde masse sur la lame qui sectionnait le cou.
ÉCARTÈLEMENT : Supplice qui consistait à démembrer un condamné, lié sur une roue, à l’aide de quatre chevaux qui tiraient sur chacun des membres. Tout l’art et la difficulté de l’écartèlement tenaient dans le travail des chevaux qui devaient tirer d’une force égale. Pour cela, chaque bête était tenue au mors par un aide exécuteur. Les quatre aides, en même temps, surveillaient continuellement que les traits fussent également tendus et que les bêtes donnassent du poitrail bien ensemble, sans secousse, afin que les tensions fussent réparties d’égale façon sur chacun des membres distendus. Le constant et principal souci de l’exécuteur en chef était que, par manque de cohésion, un membre se disloquât et s’arrachât trop vite, à cause d’un cheval parti trop tôt ou à contretemps. Le bourreau était tenu d’acheter lui-même les bêtes nécessaires à l’exécution, afin qu’il puisse les choisir en fonction des aptitudes physiques du condamné (Ravaillac, Damiens). Il s’agissait là d’un des supplices les plus atroces que la cruauté humaine ait inventé.
ÉCHAFAUD : Plate-forme dressée sur la place publique pour l’exécution des condamnés à mort.
ÉPÉE À FEUILLE : voir GLAIVE.
ÉPÉE DE JUSTICE : voir GLAIVE.
ESTRAPADE : Supplice qui consistait à tirer un condamné en haut d’un mât ou d’une potence à l’aide d’une corde qui lui saisissait les poignets préalablement liés derrière le dos. Une fois hissé, on le laissait retomber au bout de la corde. Celle-ci, sous le choc provoqué par l’arrêt de la chute, disloquait les bras.
EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE : Bourreau.
EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS : Bourreau.
EXÉCUTEUR DES SENTENCES CRIMINELLES : Bourreau.
EXÉCUTION EN EFFIGIE : Ce n’était pas seulement sur les personnes que les bourreaux avaient à exercer leur OFFICE; par défaut, ils pendaient ou brûlaient des mannequins qui étaient censés représenter les condamnés dont on n’avait pu se saisir. Les coupables étaient condamnés à l’AMENDE HONORABLE et étaient portés dans un tombereau servant à enlever les immondices. Parfois les mannequins avaient le POING COUPÉ sur un étal à ce destiné et ensuite attachés à un poteau avec une chaîne de fer, brûlés vifs et leurs corps réduits en cendres et jetés au vent. Parfois encore on les pendait à une POTENCE pour servir d’exemple et inspirer de la terreur aux méchants.
EXÉCUTION CAPITALE : voir PEINES CAPITALES.
EXECUTIONER : (anglais) Bourreau.
EXECUTOR JUSTICEA CRIMINALIS : (latin) Bourreau.
EXPOSITION : voir FLÉTRISSURE.
FLÉTRISSURE : Marque au fer rouge. Quand il s’agissait de condamnés à flétrir, le bourreau déposait sur un petit échafaud un réchaud plein de charbons allumés et un soufflet. Dans un réchaud rougissaient des fers marqués d’une fleur de lys ou bien portant l’empreinte des lettres suivantes:
- T comme travaux forcés (ou GALÈRES);
- P comme perpétuité;
- F comme faussaire;
- V comme voleur
Ce qui pouvait donner les combinaisons :
- TF pour les faussaires condamnés aux travaux forcés (ou GALÈRES);
- TP pour les travaux forcés (ou GALÈRES) à perpétuité;
- TPF pour les faussaires condamnés aux travaux forcés (ou GALÈRES) à perpétuité;
Le condamné était attaché à un poteau sur lequel était fixé un écriteau indiquant le méfait et la peine prononcée. L’EXPOSITION durait une heure. Un quart d’heure avant la fin, le bourreau dépouillait le patient jusqu’à la ceinture et lui appliquait les marques sur l’épaule droite et quelquefois sur les deux épaules.
Immédiatement après l’application de la MARQUE, on recouvrait la brûlure d’une pommade faite de saindoux et de poudre à fusil pulvérisée.
FOUET : Pour le supplice du fouet le condamné marchait nu jusqu’à la ceinture, derrière la charrette du bourreau à laquelle il était attaché. Le bourreau suivait portant une poignée de verges de bouleau. A chaque place publique indiquée, il appliquait au condamné le nombre de coups fixé par l’arrêt.
FOURCHES PATIBULAIRES : Ensemble de GIBETS. Le nombre de leurs piliers variait suivant la qualité des seigneurs : le roi pouvait en avoir autant qu’il voulait, les ducs en avaient huit, les comtes six, les barons quatre, les châtelains trois et les simples gentilshommes hauts justiciers deux. On y suspendait les criminels qu’on y laissait pourrir et dévorer par les oiseaux de proie. Le plus fameux était celui de la prévôté de Paris, situé à Montfaucon, aux portes de la ville. On y pouvait suspendre soixante criminels; au-dessous, une cave servait de charnier et recevait les restes des suppliciés. Quelques hommes illustres furent pendus à Montfaucon, tels que Enguerrand de Marigny et Semblançay. Il existait d’autres fourches patibulaires dans différents endroits de Paris et aussi à Saint-Germain-en-Laye. Malgré l’aspect hideux de ces édifices et l’odeur empestée qu’exhalaient les cadavres, le voisinage de ces lieux d’exécution était garni de cabarets, où l’on se livrait aux réjouissances et aux plaisirs.
FUSTIGATION : voir FOUET.
GALÈRES (LES) : Peine de ceux qui étaient condamnés à ramer sur ces navires. On manquait toujours de condamnés pour les galères qui réclamaient un personnel important et souvent renouvelé. Des édits ou instructions royales enjoignaient périodiquement aux juges et aux parlements de condamner le plus de monde possible à cette peine, entre autres l’édit de Charles IX en 1654, les lettres patentes d’Henri IV en 1606 et les instructions de Louis XIV en 1662.
GIBET : POTENCE située à l’entrée des villes et des villages ou étaient suspendus les cadavres des exécutés.
GLAIVE : Le glaive de justice était généralement une arme lourde, à lame longue et large, pointue à son extrémité. Cette épée d’exécution, dite ÉPÉE À FEUILLE, se tenait à deux mains. Aussi fallait-il des hommes forts pour manier cet instrument que l’on frappait puissamment L’exécuteur faisait tourner l’arme trois fois dans l’espace au-dessus de sa tête pour lui donner la force de trancher, puis la laissait tomber de tout son poids sur l’arrière de la tête du condamné. La chose n’était pas aisée. Le cou, à cause de la colonne vertébrale, est plus résistant qu’on ne le pense. Plusieurs comptes-rendus d’exécution font état d’épées de justice ébréchées pendant des décollations. Il existait plusieurs processus de décapitation par le glaive; soit le condamné appuyait sa tête sur un billot de bois, les mains liées, en principe, derrière son dos; soit le condamné était à genoux, droit ou assis sur ses talons, la tête dans l’axe du corps, le menton ramené sur la poitrine de façon à présenter toute sa nuque à l’exécuteur, et il avait souvent les mains liées devant lui ou bien encore le condamné était exécuté debout. C’était la forme de décapitation la plus rare et la plus difficile. Elle était pleine de risques, non seulement pour le bourreau qui pouvait moins bien assurer et appuyer son coup, mais également pour le condamné qui risquait fort de se faire frapper au crâne ou à l’épaule. La décapitation debout était réservée aux personnages importants, de l’entourage du roi (chevalier de La Barre).
GRAISSE DE PENDU : Soi-disant graisse humaine que le bourreau vendait pour soigner quelques maladies.
GUÉRISSEUR : Botaniste et chirurgien tout à la fois, le bourreau connaissait la vertu des simples et savait guérir les entorses, les luxations et les fractures. Puisqu’il s’entendait si bien à casser les membres, pourquoi ne s’entendrait-il pas à les remettre? Il était le REBOUTEUX par excellence. La superstition qui s’attachait aux pendus réjouissait naturellement les bourreaux à qui l’on accordait aussi des pouvoirs de guérison quasi miraculeux, héréditaires comme leur charge. Mais, surtout, on leur prêtait le don de savoir concocter des crèmes et des onguents aux pouvoirs extraordinaires, à base d’os ou de GRAISSE DE PENDU, qu’ils vendaient à prix d’or.
GUILLOTINE : Instrument de supplice destiné à trancher la tête des condamnés à mort au moyen d’un couperet glissant le long de deux montants verticaux.
GUILLOTINAGE : DÉCAPITATION au moyen de la GUILLOTINE.
HACHE : Pour la DÉCAPITATION à la hache, il n’existait qu’une seule méthode: le condamné devait poser son cou sur le billot, et la lourde lame venait le frapper en force.
HALBMEISTER : Équarrisseur, éboueur.
HAUTES ŒUVRES : Exécutions à mort sur un ÉCHAFAUD, par opposition aux BASSES ŒUVRES qui s’exécutaient à hauteur du sol.
HAVAGE : Le droit de havage du bourreau était la majeure partie de son salaire, hormis ses primes d’exécution. A l’origine, on accordait au bourreau le droit de plonger sa main dans les sacs de grains pour prélever sa havée, mais les marchands prétendaient que la marchandise était ensuite invendable parce que souillée par une telle main. L’usage s’établit de prélever avec une cuillère, qui devint elle aussi matière à contestation, les marchands la trouvant toujours trop grande. Ces perceptions étant double les jours d’exécution, s’ensuivaient des disputes homériques qui tournaient parfois au pugilat.
LETTRE DE PROVISION D’OFFICE : Document par lequel l’autorité (Seigneur, Bailli, Évêque, Roi) instituait le bourreau dans sa fonction d’exécuteur. Il devenait ainsi officier du bailliage, ou de l’évêché comme le stipule la lettre de provision d’office ci-dessous:
Claude de Saint-Simon, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, évêque de Metz, comte et pair de France, province du Saint-Empire. A tous ceux qui ces présentes verront salut. L’office d’Exécuteur des sentences criminelles et Maître des hautes œuvres de notre ville de Vic et ressort du bailliage d’icelle estant vacant par le décès de Claude Parisot, dernier paisible possesseur d’iceluy, et désirant le faire remplir par une personne à ce idoine et capable. Nous, sur le témoignage qui nous a été rendu : de celle de Jean Parisot, fils dudit Claude Parisot à iceluy pour ces causes avons donné et octroyé, donnons et octroyons ledit office d’Exécuteur des sentences criminelles et de Maître des hautes œuvres du bailliage de notre Évêché séant à Vie pour ledit office avoir tenir en jouir et d’iceluy faire l’exercice et les fonctions aux droits fruits, profits et émoluments y appartenant tels et semblables qu’en a jouy ou deus jouïr Ledit Claude Parisot père, et pour le temps qu’il nous plaira seulement. Mandons au lieutenant criminel et gens tenans notre dit bailliage que leur étant apparu de bonne vie et mœurs, religion catholique apostolique et romaine dudit Jean Parisot, et de luy pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumé ils le mettent et instituent ou fassent mettent et instituer de par nous en possession et jouissance du dit office, l’y fassent connaître par tous nos vassaux sans souffrir luy être fait aucun trouble n’y empêchement au contraire car ainsi l’avons ordonné en tesmoins de quoi avons les présentes signé de notre main fait contresigner par l’un de nos secrétaires et à icelles fait mettre et apposer notre scel de nos armes. Donné à Metz en notre palais épiscopal le vingt-quatre décembre mil sept cent trente-quatre. Signé: Cl. De Saint-Simon, Ev. De Metz
LOUISETTE : Surnom de la GUILLOTINE sous la Révolution (dérivé de Louis, le prénom de Guillotin).
LOUISON : Surnom de la GUILLOTINE sous la Révolution (dérivé de Louis, le prénom de Guillotin).
LUCARNE (LA) : Surnom donné à la GUILLOTINE au XIXe siècle.
MAIN DE GLOIRE : La main de gloire est une sorte de chandelle faite avec de l’huile de sésame, de la cire vierge et de la GRAISSE DE PENDU. Elle a pour chandelier une main de pendu séchée au soleil dans un suaire avec du sel, du vitriol vert, du salpêtre et du poivre. Ce précieux flambeau était particulièrement utile aux voleurs car, à sa lumière, les gens tombaient dans un magique sommeil et l’on pouvait pénétrer sans crainte dans la maison la mieux gardée.
MAÎTRE DE LA HAUTE JUSTICE : Bourreau.
MAÎTRE DES BASSES ŒUVRES : AIDE BOURREAU chargé des tâches subalternes ou de la voirie.
MAÎTRE DES HAUTES ŒUVRES : Bourreau.
MANDRAGORE : Dans l’imagination populaire, la mandragore est une plante qui naissait spontanément à minuit, sous le GIBET des suppliciés nouvellement pendus. Elle avait la propriété d’enrichir son heureux possesseur et de mettre à l’abri de tout maléfice; mais on était frappé de mort subite dès qu’on la touchait pour la cueillir! Aussi, pour l’arracher du sol avait-on recours à un chien qui était attaché à la plante au moyen d’une corde.
MARQUE : voir FLÉTRISSURE.
MASSICOT (LE) : Surnom donné à la GUILLOTINE au XXe siècle.
MEIGE : GUÉRISSEUR suisse au XVIIIe siècle.
MEISTER : Maître suivi du prénom, pouvait désigner le bourreau avant le XVIIIe siècle.
MINISTER JUSTICEA CRIMINALIS : (latin) Bourreau.
MIRABELLE : Surnom de la GUILLOTINE sous la Révolution (dérivé de Mirabeau).
MONTE-À-REGRET (LA) : Surnom donné à la GUILLOTINE sous la Révolution.
NACHRICHTER : Bourreau. Littéralement: après-juge ou dernier-juge.
OFFICE : voir LETTRE DE PROVISION D’OFFICE.
PARRICIDE : voir POING COUPÉ.
PEINES CAPITALES : Les peines capitales ou supplices capitaux, ramenés au nombre de cinq, étaient, par ordre croissant d’importance :
- La DÉCAPITATION, privilège de la noblesse.
- La PENDAISON, prévue pour cette série de crimes : homicide, recel de grossesse, faux-monnayage, rapt, stupre, banqueroute frauduleuse, faux, péculat, larcins et vols domestiques, plagiat, tenue d’assemblées illicites, port d’armes interdites, appel à la sédition et à l’émeute populaire.
- La ROUE, pour le châtiment de l’assassinat, du meurtre des maîtres par leurs domestiques, du vol sur les grands chemins, du parricide et du viol.
- Le BÛCHER, ou feu vif, réservé aux crimes de magie, d’hérésie, de sortilège et de blasphème ; à la sodomie, à l’inceste et à la bestialité ; à l’incendie volontaire et à l’empoisonnement.
- L’ÉCARTÈLEMENT, appliqué aux régicides et aux coupables de lèse-majesté.
Toutes ces peines succédaient obligatoirement à l’AMENDE HONORABLE du condamné.
PEINES INFAMANTES : Les peines, dites infamantes, comprenaient, à la veille de la Révolution :
- La RÉCLUSION à terme, ou perpétuelle.
- Le PILORI et le CARCAN, réservés aux soldats et aux domestiques insolents ; aux mendiants, aux voleurs à la tire, aux fraudeurs ; aux proxénètes et aux bigames.
- Le PERCEMENT DE LA LANGUE des blasphémateurs.
- La MARQUE, le FOUET, le BANNISSEMENT et les GALÈRES pour la majorité des voleurs, des brigands et des satyres.
Toutes ces peines succédaient généralement à l’AMENDE HONORABLE du condamné.
PENDAISON : Mise à mort d’un condamné par un système de nœud coulant passé autour de son cou et que l’on attachait à une potence ou à un arbre. C’était le châtiment des roturiers, par opposition aux nobles que l’on décapitait Il n’était pas rare de voir le bourreau, afin de bâter la strangulation, peser de tout son poids sur le corps du condamné. Tout au long des XVIIe et XVIIe siècles, jusqu’à la Révolution, le bourreau de Paris plaçait le nœud coulant sous la mâchoire et l’os occipital du condamné, ce qui faisait une contre-extension qui lui brisait le cou dans la plupart des cas. Aujourd’hui, dans la méthode anglaise, la corde est placée sur le côté gauche de la mâchoire inférieure. Cette méthode a pour avantage de briser plus certainement la colonne vertébrale.
PERCEMENT DE LA LANGUE : La langue percée à chaud ou à froid était la peine des blasphémateurs, des athées, des impies, des détracteurs de la foi catholique et des libertins, sans préjudice des GALÈRES (Édit de 1681).
PHOTOGRAPHE : L’un des AIDES BOURREAUX avait une fonction particulièrement importante et souffrait d’un injuste oubli. Il était désigné dans l’argot de la pègre du surnom de photographe. Grâce à lui, les exécutions, souvent, ne dégénéraient pas au carnage. Il était chargé de vérifier que le condamné se tienne droit, la nuque bien offerte au couperet, et ne rentrait pas la tête dans les épaules. Il se tenait donc devant la guillotine et, si besoin était, tirait le condamné par les cheveux, ou les oreilles s’il était chauve, pour un ajustement de dernière seconde. Trouver le bon angle ou plutôt la bonne pose lui valut son surnom.
PILORI : Le pilori, comme le CARCAN, consistait presque toujours en un simple poteau auquel tenait un collier de fer qu’on passait au cou du condamné. C’était la peine ordinaire des banqueroutiers frauduleux.
POING COUPÉ : Sur un billot, haut d’un pied, le condamné, à genoux, posait à plat son poignet que le bourreau faisait immédiatement sauter d’un coup de hachette; le moignon était aussitôt lié dans un sac rempli de son.
POTENCE : Instrument, servant au supplice de la PENDAISON.
QUESTION : Supplice officiel. Selon la gravité du cas et d’après les termes de l’arrêt, il y avait trois sortes de questions :
- la question préalable ou préparatoire qui était appliquée au condamné à mort soupçonné d’avoir eu des complices, pour le contraindre à avouer leurs noms. Elle fut abolie par Louis XVI en 1780.
- la question ordinaire ou simple qui ne pouvait être appliquée que dans le cas où il y avait une demi-preuve contre le prévenu d’un crime puni de mort.
- la question extraordinaire, beaucoup plus cruelle, s’employait contre les condamnés à mort pour les forcer à révéler leurs complices. Il y avait la question à eau ou par extension et la question par les BRODEQUINS, lesquelles exigeaient un savoir-faire spécial.Voici d’après l’ordonnance de 1697 la description des moyens employés pour faciliter l’expression de la vérité :
«La question sera donnée dans une chambre spéciale en présence du rapporteur et de l’un des juges du procès. Il y aura une SELLETTE pour faire asseoir l’accusé pendant son interrogatoire, un bureau pour le greffier et un petit tableau pour l’Évangile sur lequel le patient jurera de dire la vérité. Deux chirurgiens et un médecin seront préalablement consultés et donneront leur avis sur l’état de l’accusé afin de savoir si ses forces lui permettent de supporter la torture sans danger pour sa vie.» - Question à eau ou par extension : On allume un grand feu dans la cheminée devant laquelle on étend un matelas sur lequel on place le patient à la fin de la torture ou plutôt s’il demande à faire des révélations. Pour la question ordinaire ou préparatoire, on dresse un petit tréteau de deux pieds de haut sur lequel on étend le questionné, les membres tendus par des cordes à des anneaux scellés dans le mur. Le QUESTIONNAIRE lui soulève la tête, lui serre le nez et, au moment où il ouvre la bouche pour respirer, introduit le bout d’une corne sciée par la plus petite extrémité. Dans cette corne formant entonnoir, il verse lentement et de haut quatre coquars d’eau, mesure de Paris de deux pintes et chopine chacun (a). L’hiver on fait un peu chauffer l’eau. Un récipient est placé sous la tête de l’accusé pour recueillir ce qui pourrait tomber du liquide, afin que rien ne soit perdu et qu’il n’y ait ni faveur, ni supercherie. Pour la question extraordinaire, mêmes précautions. Le condamné est bandé à force d’hommes le plus fortement possible. Puis le QUESTIONNAIRE reprend sa corne et verse quatre nouveaux coquars d’eau (b).
- Les BRODEQUINS : Le patient est déchaussé jusqu’aux genoux. On le fait asseoir, on lui lie les bras et on lui fait tenir les jambes d’aplomb. De chaque côté des deux jambes, on lie deux planches, l’une en-dedans, l’autre en-dehors, fixées par des courroies sous le genou et au-dessus de la cheville. Les deux jambes sont ensuite assemblées au moyen d’autres courroies bien serrées. Alors, entre les deux planches placées dans l’intérieur des jambes on fait entrer des coins à grands coups de maillet par en haut et par en bas. La question ordinaire est de quatre coins, l’extraordinaire de huit Si les forces du malheureux viennent à défaillir, on lui donne un peu de vin.L’accusé auquel la torture n’avait arraché aucun aveu était réputé innocent. Après la question venait la peine corporelle, trop souvent mortelle, à l’exclusion des PEINES INFAMANTES.
QUESTIONNAIRE : Bourreau qui applique la QUESTION.
RASOIR NATIONAL (LE) : Surnom donné à la GUILLOTINE sous la Révolution.
REBOUTEUX : voir GUÉRISSEUR.
RESTAURATEUR DU CORPS HUMAIN : voir GUÉRISSEUR.
RETENTUM : Article non-exprimé dans un arrêt, mais qui n’en devait pas moins recevoir son exécution. La Cour mettait parfois en retentum que le criminel serait étranglé au premier, au second, ou au troisième tour de roue, afin d’abréger ses souffrances.
ROUE : C’est ainsi que l’on nommait la peine capitale qui impliquait que l’on fût rompu vif, le corps attaché à une roue. Dans chacune des quatre branches de la roue étaient pratiquées deux entailles, à environ un pied l’une de l’autre, afin de créer des vides sous les membres attachés sur ces branches, aux endroits où l’exécuteur devait frapper. Le criminel était étendu sur cette croix, la face tournée vers le ciel, et le bourreau, armé d’une barre de fer carrée, rompait d’un coup violent les cuisses, les jambes, les bras et les avant-bras du misérable ; il terminait l’affreuse opération par deux ou trois coups sur la poitrine. On attachait alors le supplicié sur une roue placée horizontalement au sommet d’un poteau, les jambes repliées sous le torse; c’est là qu’il achevait de mourir. C’est le supplice que subirent Cartouche et Mandrin.
SCHARFRICHTER : Bourreau. Littéralement : juge-tranchant (Alsace, Bâle, Saint-Gall, Pays de Bade).
SCHINDER : Équarrisseur, éboueur.
SELLETTE : Siège de bois fort bas qui était disposé dans le prétoire des tribunaux criminels et sur lequel on faisait asseoir l’accusé pour subir son dernier interrogatoire, lorsqu’il était conclu contre lui à l’application d’une peine afflictive. Cet interrogatoire était le dernier acte de l’instruction dans les procès au grand criminel ; il précédait immédiatement la sentence. De là vient l’expression être mis sur la sellette.
SUPPLICE : voir QUESTION.
SUPPLICES CAPITAUX : voir PEINES CAPITALES.
SURVIVANCE : voir LETTRE DE PROVISION D’OFFICE.
TORTURE : voir QUESTION.
TOURMENTEUR JURÉ : voir QUESTIONNAIRE.
VALET DE BOURREAU : voir AIDE BOURREAU.
VASISTAS (LE) : Surnom donné à la GUILLOTINE sous la Révolution.
VENGEUR DU PEUPLE : Bourreau (sous la Révolution).
VEUVE (LA) : Surnom donné à la GUILLOTINE sous la Révolution.
WASENMEISTER : Équarrisseur, rifleur, éboueur et pour désigner le valet du bourreau (par opposition au maître).
a) La pinte de Paris valant 0,93 litre et la chopine 0,46 litre, le coquar représentait 2,38 litres et, par conséquent, les quatre coquars ingurgités par le patient équivalaient à 9,52 litres.
b) Soit au total 19,04 litres d’eau!
Extraits du Dictionnaire historique et anecdotique des bourreaux, de Michel et Danielle Demorest. Reproduit avec l’aimable autorisation des auteurs.
A lire …
- Michel et Danielle Demorest, Dictionnaire historique et anecdotique des bourreaux
- Jacques Delarue, Le métier de bourreau
- Michel Folco, Dieu et nous seuls pouvons
- Eugène Olivier, Bourreaux et guérisseurs, Médecine et santé dans le pays de Vaud au XVIIIe siècle
- Olivier Pasteur, Les bourreaux en Suisse : la dynastie des Pasteur
- Olivier Pasteur, La lignée de Jacob Pasteur, Exécuteur de haute justice à Bienne (1656)
- Diderot et d’Alembert, L’exécuteur de haute justice (extraits de l’Encyclopédie)
- Emplois de bourreau, dans Le Canard Enchaîné du 3 octobre 2001
Voir aussi:
